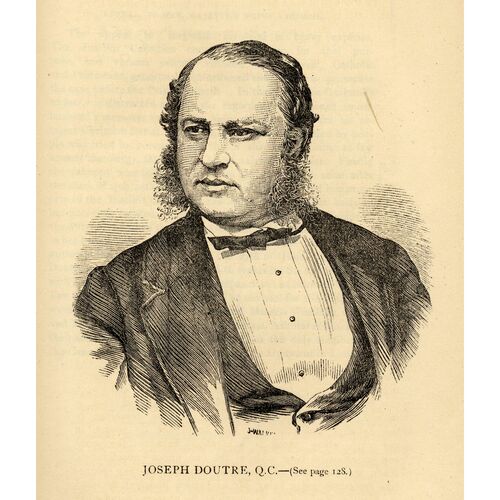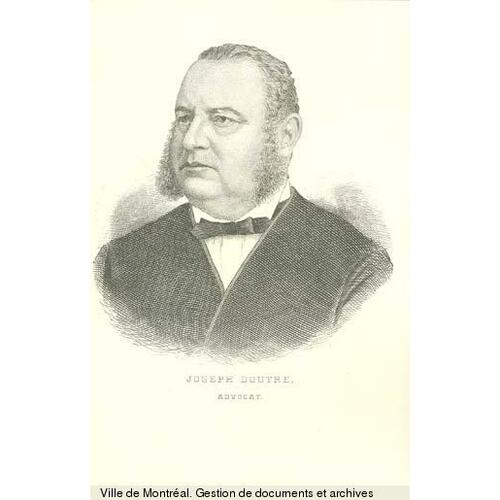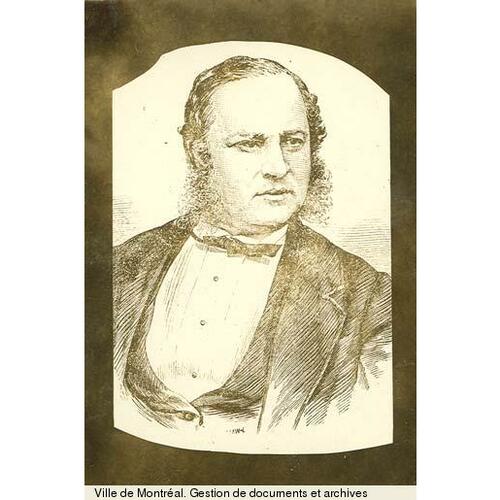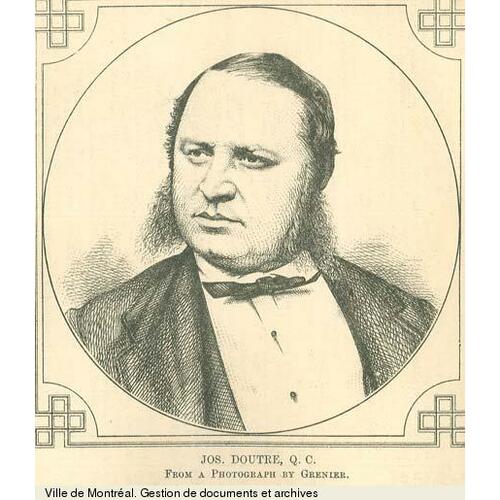DOUTRE, JOSEPH (baptisé Joseph-Euloge), journaliste, écrivain et avocat, né à Beauharnois, Bas-Canada, le 11 mars 1825, fils de François Doutre et d’Élisabeth Dandurand, dit Marcheterre, décédé à Montréal le 3 février 1886.
Joseph Doutre passa son enfance à Beauharnois, village qui portait le même nom que la seigneurie dont il faisait partie. Exerçant le métier de cordonnier, son père y était, de plus, sacristain de l’église Saint-Clément. Ce n’est pas le moindre paradoxe de cette existence mouvementée que l’adversaire le plus résolu qu’ait connu l’Église au Québec durant la deuxième moitié du xixe siècle ait été élevé à l’ombre de l’autel de sa paroisse natale ! Le jeune Doutre fréquenta sans doute l’école élémentaire de Beauharnois avant d’entrer au petit séminaire de Montréal, en septembre 1836. Le directeur du séminaire au moment où Doutre y fit ses études classiques était le sulpicien français Joseph-Alexandre Baile. Fait à noter, Doutre, même au plus fort de ses campagnes anticléricales, ne se permit jamais le moindre dénigrement à l’endroit de ses anciens maîtres. Il rencontra au séminaire des jeunes gens qu’il devait retrouver dans la vie, en particulier Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme*, son collègue au barreau, Magloire Lanctôt* et William Oscar Dunn, père d’Oscar Dunn, le journaliste veuillotiste.
À sa sortie du séminaire en 1843, Doutre se mit à l’étude du droit sous la direction d’abord de Norbert Dumas, puis d’Augustin-Norbert Morin* et enfin de Lewis Thomas Drummond. Il fut admis au barreau le 30 avril 1847. Encore étudiant en droit, il commença à écrire et à publier. Il tâta du journalisme. Il collabora d’abord aux Mélanges religieux (Montréal) et à l’Aurore des Canadas (Montréal). Dans le Ménestrel (Québec) des 17 et 21 novembre 1844, il faisait paraître un conte : « Faut-il le dire ! ... » Au même moment, les deux premières livraisons de son roman, les Fiancés de 1812 [...], étaient distribuées aux souscripteurs. Grâce à Doutre, Montréal se mettait brusquement à l’heure de Paris dans le domaine romanesque. Sur les bords du Saint-Laurent, l’étudiant en droit s’essayait à imiter Eugène Sue, que Charles-Augustin Sainte-Beuve considérait alors comme le romancier le plus en vogue en France et en Europe. Ce succès, Sue le tenait des « Mystères de Paris », qui parurent d’abord dans le Journal des débats (Paris) du 19 juin 1842 au 15 octobre 1843. Le rédacteur en chef du Courrier des États-Unis (New York), Théodore-Frédéric Gaillardet, reproduisit le roman de Sue dans la Semaine littéraire, de sorte que le libraire montréalais Édouard-Raymond Fabre* pouvait livrer à des lecteurs impatients la suite des « Mystères de Paris » au fur et à mesure qu’elle s’imprimait à New York.
Le roman de Sue exerça sur Doutre une influence proprement séminale. La lecture des « Mystères de Paris » le révéla à lui-même : « J’obéis, écrivait-il quatre ans après la publication des Fiancés de 1812, à l’énergie qui se révoltait en moi contre la tiédeur des temps. » En 1844, à l’âge de 19 ans, sous la tutelle de Sue, il avait amorcé sa lutte contre les préjugés, l’ignorance et l’inertie des Canadiens français. Contre aussi une religion qui dégénérait trop souvent en pharisaïsme. Il s’en prenait à l’intolérance religieuse, à l’hypocrisie benoîte représentée par « ces pieux chevaliers de manchette, qui passent leur vie à l’église ou sous la soutane d’un prêtre », mais qui ne sont pas moins véreux en affaires. Aussi pour lui la lecture de romans du genre des « Mystères de Paris » était-elle « une savante école de discipline privée et publique », car elle dévoilait efficacement « les vices de l’organisation sociale, le défaut d’institutions publiques pour l’encouragement de la vertu ».
Doutre réclamait l’indulgence du public pour son ouvrage. Son ambition était de « donner quelque essor à la littérature parmi [ses compatriotes] ». Mais la réalisation n’était pas à la hauteur des aspirations d’un jeune homme dont les idées, très modernes au point de vue social, étaient au service d’un art inexpérimenté qui, au surplus, heurtait la sensibilité de maint lecteur, au point que les Mélanges religieux jugèrent que les Fiancés de 1812 étaient « une œuvre assez immorale pour que les pères en défendissent la lecture à leurs enfants et pour que la femme qui en commençait la lecture ne pût s’empêcher de rougir et de rejeter loin d’elle une pareille production » . Deux ans plus tard, Doutre faisait paraître un récit, « le Frère et la Sœur », inspiré manifestement du René de Chateaubriand, mais où le thème de la tentation incestueuse était singulièrement édulcoré. Il y faisait un retour sur ses années passées à Beauharnois, alors qu’il avait « battu plus d’une fois les sentiers ombreux du domaine seigneurial. Plus d’une fois aussi l’écho de ses bois avait répété le bruit inoffensif de [son] fusil inhabile. » Doutre ne s’attarda pas davantage aux exercices gratuits de la plume : la pratique du droit et les jeux de la politique allaient désormais requérir tous ses soins.
Contrairement à ce que plusieurs historiens ont affirmé, Doutre ne figurait pas parmi les jeunes gens qui, le 17 décembre 1844, jetèrent les bases de l’Institut canadien de Montréal. Mais il ne tarda pas à rejoindre le groupe où il s’imposa bientôt comme l’un de ses chefs de file et, en juillet 1847, il était au nombre des « Treize » qui constituaient le premier noyau des collaborateurs de l’Avenir. D’abord favorables au parti réformiste, à telle enseigne qu’en avril 1848 Doutre et ses amis pouvaient se vanter, dans leur journal, d’avoir contribué à l’élection de Louis-Hippolyte La Fontaine* et se dire « les véritables amis du ministère », les Treize se rangeaient, dès le mois suivant, derrière Louis-Joseph Papineau*, qui appliquait aux affaires canadiennes le principe alors révolutionnaire des nationalités, et attaquaient l’Union. Dès lors Doutre s’affirma comme l’un des plus tenaces adversaires du parti ministériel. Lorsque l’Avenir publia, en août 1848, « la Tuque bleue », écrit satirique dû probablement à la plume de Louis-Antoine Dessaulles* mais que George-Étienne Cartier* attribua à Charles Daoust*, c’est Doutre qui se battit en duel contre Cartier, qui se considérait comme vilipendé par ce libelle.
Le clergé, qui en était venu à la conviction que l’Avenir cherchait « à répandre des principes révolutionnaires », comme l’écrivait Mgr Ignace Bourget dans sa lettre pastorale du 18 janvier 1849, se mit à appuyer de moins en moins discrètement le parti de La Fontaine et de Robert Baldwin*. Lorsque l’Avenir prôna l’annexion du pays aux États-Unis et réclama la suppression des dîmes, l’opposition cléricale aux « rouges » s’affirma encore plus ostensiblement, au point que Doutre crut ou voulut croire à l’existence d’une lettre que lord Elgin [Bruce*] aurait écrite aux évêques pour leur demander d’étouffer le mouvement annexionniste. Il coiffait sa diatribe insérée dans l’Avenir du 24 novembre 1849 d’un titre provocateur : « Proposition infâme ! Le peuple au marché ! » Un an plus tard, sous le titre « Chronique religieuse », il publiait un long factum dans lequel l’anticléricalisme explosait avec une véhémence qui n’aura guère de parallèle dans la littérature canadienne-française. Doutre réglait son compte au « parti mixte, politico-religieux », qui tablait sur l’ignorance politique et sociale du peuple pour l’empêcher de donner « tous les quatre ans un vote désintéressé pour la gestion de nos affaires publiques ». La source de cette ignorance ? L’instruction religieuse telle que la donnaient les écoles et collèges sous la coupe du clergé : « elle seule en est la cause ; car voici en résumé quels sont les principes sociaux de la masse de notre population : manger et prier Dieu [...] On leur a appris à mépriser, à fuir tout le reste. »
L’hostilité cléricale aux thèses de l’Avenir explique l’exaspération de la formule. L’évolution de la politique canadienne depuis 1848 avait exercé une influence déterminante sur la radicalisation de la pensée de Doutre : il en était arrivé, en 1850, à soutenir la thèse essentielle du libéralisme politique, la séparation de l’Église et de l’État, et par voie de conséquence l’exclusion du clergé de la politique et l’accent mis sur l’éducation laïque non confessionnelle. À 25 ans, Doutre avait adopté la ligne de conduite de laquelle il ne déviera plus.
Lors du sixième anniversaire de la fondation de l’Institut canadien, le 17 décembre 1850, Doutre développa dans une causerie ce que devait être le but d’une éducation vraiment moderne. Après avoir rappelé que le jeune homme qui sortait du collège ne comprenait rien aux réalités et aux mots tels que revenus, taxes, commerce, politique, élections, droit public, ni même à sport, modes, bals, théâtre, il affirmait que, grâce à l’Institut canadien, ce même jeune homme, en entrant dans le monde, pouvait désormais trouver immédiatement sa place. Cet institut, selon Doutre, avait ouvert à toutes les classes, sans distinction, « la perspective des grandeurs humaines et des honneurs attachés aux dignités publiques » ; aussi voyait-on des jeunes gens engagés dans les arts mécaniques rivaliser avec les hommes appartenant aux professions libérales. L’exercice de la parole n’était plus le monopole des membres du barreau, l’art d’écrire était mis à la portée de tous, « et partout, ajoutait-il, vous trouverez le levier immense de la presse entre les mains des jeunes gens dont l’apparition dans le monde politique ne date que de la création de nos sociétés de réunion et de discussion ».
C’est parce qu’il était une création laïque, libre de l’emprise cléricale, que l’Institut canadien s’engageait dans la voie du progrès. Doutre en avait administré la preuve a contrario lorsqu’il avait fustigé, dans l’Avenir du 6 avril 1850, le « petit coup d’État » du comité de la bibliothèque de l’Institut canadien de Québec, qui venait de voter le renvoi de l’Avenir. Or qui figuraient dans ce comité ? Les abbés Louis Proulx*, Jean Langevin* et Elzéar-Alexandre Taschereau*, représentants du parti clérical, et le « révérend » Joseph-Édouard Cauchon, représentant du parti ministériel, en raccourci ce qu’il allait stigmatiser de l’appellation « le parti mixte, politico-religieux » : « les chaires et le confessionnal, s’indignait-il, ne suffisaient pas pour lui ; il s’est emparé de la direction d’une institution publique, fondée sur l’exemple de la jeunesse de Montréal ; il s’en est emparé pour y comprimer la pensée et l’opinion, pour en proscrire la discussion et l’examen, pour arrêter l’expansion de doctrines trop justes pour n’être pas comprises et acceptées, pour lui donner enfin cette physionomie d’assemblée d’ignorantins qu’il sait si bien façonner ».
Lorsque l’Avenir cessa momentanément de paraître, en janvier 1852, Doutre s’affirma de plus en plus sur la scène de l’Institut canadien, dont le président fut, à compter de mai 1852, le « citoyen » Pierre Blanchet. Les esprits avancés l’emportaient sur les modérés, qui finalement se décidèrent à fonder une association rivale, l’Institut national, qu’ils placèrent sous le patronage de Bourget. Cette sécession ne perturba en rien la marche ascendante de l’Institut canadien, si l’on en juge par le détachement olympien avec lequel Doutre, dans le « huitième rapport annuel » publié en décembre 1852, signalait que neuf membres avaient quitté l’institut dans le cours de l’année, dont deux « pour entrer dans une nouvelle société fondée le printemps dernier ».
Doutre avait remporté en 1851, lors d’un concours organisé par l’Institut canadien, un prix décerné par le conseiller législatif Pierre-Amable Boucher de Boucherville pour un essai intitulé « Du meilleur emploi qu’un citoyen peut faire de son existence tant pour la société que pour sa famille » ; l’année suivante, il publiait « les Sauvages du Canada en 1852 [...] », causerie prononcée devant l’institut sur les Iroquois de Caughnawaga, travail qu’il caractérisait lui-même comme « des observations assez frivolement recueillies dans le cours de deux ou trois ans et cousues ensemble par une étude de vingt-quatre heures, faite sur les lieux et gravée d’après nature ». Doutre exerçait par la fermeté de sa pensée et son ardeur au travail une telle emprise sur ses confrères qu’ils l’élurent, en novembre 1852, président de l’Institut canadien pour un mandat d’un an. C’est sous sa présidence que l’association obtint la personnalité civile ; elle fut en mesure d’acquérir, au début de 1854, un vaste édifice rue Notre-Dame. Un journaliste ami pouvait alors écrire : « L’Institut canadien est maintenant bâti sur le roc. »
Cette année allait être particulièrement faste pour le groupe. Si Doutre ne figurait pas parmi les 11 membres de l’institut que les électeurs envoyaient siéger au parlement, il se signala par le rôle qu’il joua dans la « convention » organisée par l’institut sur l’abolition de la tenure seigneuriale. Doutre réclamait l’abrogation de la tenure depuis 1849, ayant clairement indiqué, dans l’Avenir du 4 mai 1850, que sur cette question il se séparait de Louis-Joseph Papineau et de Louis-Antoine Dessaulles, eux-mêmes seigneurs. Il avait, de son côté, vécu dans un village qui faisait partie d’une seigneurie et de là venait peut-être son opposition à un tel système. Mais c’est surtout à propos de la question de l’éducation qu’il fut actif. À l’occasion du décès, en juillet 1854, du libraire Édouard-Raymond Fabre, ami intime de Papineau et l’un des fondateurs de la feuille libérale le Pays (Montréal), Doutre fit l’éloge du défunt devant les membres de l’Institut canadien. Il insista sur la force de caractère déployée par Fabre dans l’acquisition d’une formation d’homme d’affaires à l’époque où « les maisons d’éducation commerciale étaient encore à créer ». « C’est à peine si, aujourd’hui même, poursuivait Doutre, on sait apprécier la nécessité d’une éducation prise ailleurs que dans les auteurs grecs ou latins. »
Formation pratique, comme Doutre l’avait déjà réclamée dans les colonnes de l’Avenir , mais aussi enseignement scolaire non confessionnel, que prônait une autre « convention » de l’institut portant, cette fois-ci, sur l’éducation. Toutefois le moment était vraiment inopportun pour insister sur la non-confessionnalité dans les écoles. L’évêque de Toronto, Mgr Armand-François-Marie de Charbonnel*, et les catholiques haut-canadiens luttaient alors avec acharnement pour l’existence légale des écoles « séparées ». Aussi, Doutre, prévoyant sans doute son entrée prochaine dans la politique active, jugea-t-il prudent de jeter du lest. Lors des débats de la « convention », il fit donc montre d’une modération méritoire et, tout en appuyant le principe de la neutralité scolaire, il estima qu’il était plus sage de mettre en veilleuse l’épineuse question de la confessionnalité et d’attendre « que le public se plaigne du système actuel ».
Doutre convoitait sans doute un siège au Conseil législatif depuis que celui-ci était devenu électif. Il se présenta donc, en septembre 1856, dans la division de Salaberry, mais ce fut le candidat ministériel Louis Renaud* qui l’emporta. Il tenta de nouveau sa chance, comme candidat à l’Assemblée législative, aux élections de 1863. Il connut encore une fois la défaite, dans le comté de Laprairie, quand le candidat conservateur, Alfred Pinsonnault, le battit. Il renonça alors à la vie publique, mais en gardant une haine recuite à l’endroit du clergé, car il attribuait ses échecs successifs à l’opposition cléricale.
D’autre part, l’Institut canadien était l’objet des foudres épiscopales. À la suite des trois lettres pastorales que Bourget publiait les 10 mars, 30 avril et 31 mai 1858, 138 membres démissionnaient de l’Institut canadien pour fonder une société rivale, l’Institut canadien-français. L’évêque de Montréal réprouvait avec force les thèses libérales des chefs de file de l’Institut canadien. Doutre et son beau-frère Charles Daoust étaient particulièrement visés.
En effet, à l’occasion d’un banquet offert, en février 1858, par des amis politiques de Charles Daoust, rédacteur en chef du Pays et député libéral du comté de Beauharnois de 1854 à 1857, Doutre était revenu sur la question de la neutralité scolaire pour affirmer que « le principe des écoles mixtes » lui semblait « le plus rationnel et celui qui devr[ait] un jour prévaloir ». Mais il fallait attendre le moment propice pour réaliser cet objectif : « Je ne pense pas, poursuivait Doutre, que l’état de notre éducation publique soit tel que l’on dût appliquer ce principe comme une règle absolue ou comme la base première de notre système. » C’était une déclaration publique, reproduite par le Pays du 16 février 1858, mais sa vraie pensée, Doutre la livrait à George Brown* dans la lettre qu’il lui écrivait cinq jours plus tôt : les catholiques sont surexcités et « on doit combattre les jésuites avec leur arme préférée, la diplomatie ». Il était certain qu’un jour l’on pourrait donner au Canada le système neutre que Brown préconisait car, ajoutait-il, le succès des jésuites touchait à sa fin.
Bourget ignorait évidemment la teneur de cette lettre, mais Doutre avait suffisamment dévoilé ses batteries dans son discours public pour que l’évêque détectât dans son propos le tenant obstiné de la thèse libérale de la séparation de l’Église et de l’État. S’il y avait eu la moindre ambiguïté, Daoust l’eût dissipée en claironnant, dans la même circonstance, « que l’Église et l’État devraient avoir une existence séparée, vivre chacun de leur propre vie et non s’identifier dans une action commune ». Après avoir cité cette déclaration on ne peut plus explicite, c’était là un « langage impie », s’indignait l’évêque, qui recourait aux arguments que Grégoire XVI avait développés, un quart de siècle plus tôt, dans son encyclique Mirari vos, pour stigmatiser plus efficacement ses adversaires libéraux.
Objet de l’ostracisme clérical, écarté de la vie publique, Doutre se consacra plus exclusivement à la pratique du droit. L’un de ses premiers associés fut Joseph Lenoir*, dit Rolland, poète de talent. Parmi les avocats qui firent partie, dans la suite, de son étude, il faut nommer son beau-frère Charles Daoust, ses frères Gonzalve* et Jean-Baptiste, son cousin Raoul Dandurand* et Médéric Lanctot*. D’autres se formèrent sous sa direction, en particulier Wilfrid Laurier*.
La compétence et le travail acharné de Doutre le placèrent au premier rang de sa profession. Fait conseiller de la reine le 15 août 1863, sous le gouvernement de George Brown et d’Antoine-Aimé Dorion*, il fut, à maintes reprises, membre du conseil du barreau, membre du comité de la bibliothèque, examinateur de 1864 à 1866 et bâtonnier de 1867 à 1868. Membre correspondant, depuis 1872, de la Société de législation comparée de Paris, il collaborait régulièrement à des publications juridiques comme le Lower Canada Jurist (Montréal) et le Legal News (Montréal). En 1880, il publiait chez John Lovell & Son un ouvrage de 414 pages dont le titre et le sous-titre indiquaient clairement le contenu : Constitution of Canada : the British North America Act, 1867, its interpretation, gathered from the decisions of courts, the dicta of judges and the opinions of statesmen and others ; to which is added the Quebec Resolutions of 1864, and the constitution of the United States.
Doutre plaida des causes importantes. En 1857, il s’était fait l’avocat des censitaires devant le tribunal créé pour régler les conséquences de l’abolition de la tenure seigneuriale. Trois ans plus tard, il accepta de défendre un caissier français concussionnaire du nom de Lamirande, qui était venu se réfugier au Canada. Mais la cause qui le mit le plus en relief auprès du grand public, à telle enseigne que son nom y reste attaché, fut évidemment l’affaire Guibord.
Depuis 1858, le fossé n’avait cessé de s’élargir entre l’Institut canadien et l’évêché de Montréal. Ayant appliqué dans toute leur rigueur, en dépit de l’avis de prudence de l’archevêque de Québec, à la bibliothèque de l’Institut canadien les règles de l’Index, dont la violation entraînait ipso facto l’excommunication, Bourget heurtait de plein fouet cette attitude conforme au libéralisme qui refuse à qui que ce soit le droit de surveillance et de prohibition en matière de livres et de lectures. Pour le libéral, en effet, chacun a le pouvoir de choisir à son gré ses aliments intellectuels ; les cas d’empoisonnement qui peuvent en résulter ne sont que des inconvénients accidentels, amplement compensés par un bien supérieur : la liberté.
Doutre, dont la carrière littéraire avait débuté sous l’égide d’Eugène Sue et qui, à cause de son libéralisme, se voyait tenu à l’écart d’une place à laquelle lui donnaient droit ses talents et ses aspirations dans la vie politique de son pays, dut ressentir comme une brûlure l’acte d’autorité épiscopal. Aussi peut-on s’étonner de le voir figurer dans le comité qui, en octobre 1863, fut nommé pour « s’enquérir des moyens propres à aplanir les difficultés survenues entre Sa Grandeur l’Évêque de Montréal et l’Institut ». Cette rencontre sous le toit de l’évêque n’ayant rien donné et quoique 17 membres de l’institut, y compris Doutre, se fussent adressés à Pie IX, le 16 octobre 1865, pour faire lever les censures concernant leur association, l’Institut canadien, dont Doutre avait de nouveau assumé la présidence en mai 1867, vit son Annuaire de 1868 mis à l’index par le Saint-Office. C’était le 7 juillet 1869.
Peu après la transmission à Rome d’un second appel au bas duquel figurait la signature de Doutre, l’Institut canadien perdait l’un de ses membres en la personne de l’imprimeur Joseph Guibord*, qui décédait subitement le 18 novembre 1869. Devant le refus des autorités ecclésiastiques d’accorder au défunt une sépulture catholique, sa veuve, par l’intermédiaire d’Adolphe et de Joseph Doutre ainsi que de Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme, intentait à la fabrique de Notre-Dame un procès devant la Cour supérieure de Montréal. Cette cause permit à Joseph Doutre, l’un des deux avocats de la demanderesse, de donner un retentissement national aux thèses libérales dont il se faisait, depuis bientôt un quart de siècle, l’infatigable héraut, et de s’en prendre avec une violence verbale allant parfois jusqu’à la truculence à ses adversaires ultramontains, représentés par les jésuites, qu’il soupçonnait, comme nombre de libéraux influents, au dire de Raoul Dandurand, d’être les inspirateurs de Bourget. Le jésuite Firmin Vignon n’avait-il pas, pour faire pièce à l’Institut canadien, fondé au collège Sainte-Marie, en septembre 1854, l’Union catholique ?
Ayant pris soin d’exclure de l’affaire « les vénérables prêtres de St-Sulpice, au nombre desquels se trouv[ait] le curé d’office », Doutre concentrait sa véhémence en des tirades qui rappellent les diatribes anti-jésuites les plus célèbres : « Il y a, dans le monde, s’écriait-il, un cercle d’hommes en conspiration permanente contre tout ce qui fait le bonheur matériel et moral de l’humanité, un cercle d’hommes qui se disent catholiques et qui trente-sept fois ont été proscrits par le Pape et les princes de tous les pays catholiques. » Haussant encore le ton, il explosait en une invective à la Michelet : « Honneur soit rendu aux Sauvages de ce continent qui avaient commencé à supprimer du sol canadien la première semence de la sainte Société de Jésus ! » Le résultat de l’influence des jésuites depuis leur retour en terre canadienne ? « Il suffit de quelques années pour condamner notre population à la plus crasse ignorance. Ils s’emparèrent de tout, sans paraître y toucher. L’Évêque de Montréal s’enrégimenta à leur service, est-ce comme Jésuite, est-ce comme manœuvre aveugle ? On ne le sait pas. Par l’Évêque de Montréal, ils contrôlèrent le bureau de l’Instruction publique, le choix des livres d’école, celui des institutions, la direction des études et des cours des écoles élémentaires et des écoles modèles. » Face à cette invasion conquérante des troupes ultramontaines dans le champ de l’éducation et, d’une façon plus générale, dans l’aménagement de la cité terrestre, restait une digue, un bastion qui « seul » demeurait « debout » : l’Institut canadien. Aussi était-ce sur lui seul que depuis des années « tous les efforts » étaient « concentrés ».
Doutre en arrivait ainsi, au cours de sa plaidoirie, à cerner le problème central de l’antagonisme libéral-ultramontain : l’attitude à prendre à l’égard du monde issu de la révolution intellectuelle et politique du xviiie siècle et particulièrement du régime des libertés civiles et religieuses proclamé dans la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». Si Guibord, objet de censures ecclésiastiques, était inhumé dans un cimetière catholique, c’était le triomphe sur l’autorité religieuse de l’Institut canadien et du libéralisme qu’il incarnait ; le contraire serait une variante du « parcage des morts », dans lequel des libéraux belges, à la même époque, voyaient une preuve supplémentaire de la domination politique du clergé.
L’on connaît la suite. La veuve de Guibord, plus précisément l’Institut canadien, eut gain de cause, le 2 mai 1870, devant le juge Charles-Elzéar Mondelet* de la Cour supérieure. Ce jugement, infirmé par la Cour de révision et la Cour d’appel, fut rétabli le 21 novembre 1874 parle comité judiciaire du Conseil privé. Les restes de Guibord, qui reposaient depuis novembre 1869 dans le charnier du cimetière protestant du Mont-Royal, furent solennellement transportés, le 16 novembre 1875, dans le cimetière catholique de Côte-des-Neiges, escortés par la troupe à cheval et à pied.
C’était pour Doutre un triomphe à la Pyrrhus. En effet, ce dernier rempart du libéralisme radical qu’était pour lui l’Institut canadien se désagrégeait peu à peu sous la poussée incoercible du flot montant de l’ultramontanisme. Plusieurs de ses membres les plus connus étaient décédés ou avaient fait leur soumission à l’Église. De sorte qu’au début de 1886 la Presse pouvait affirmer que l’Institut canadien n’existait plus que « nominalement ».
Mais Doutre n’avait pas désarmé. Au témoignage de Laurent-Olivier David*, il fut l’un des rares libéraux qui, après s’être éloigné de l’Église, ne retrouva point la foi de son enfance. « J’avais de l’ambition, avouait-il à son collègue Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme, je croyais avoir assez de talent et d’énergie pour faire mon chemin ; j’ai vu passer devant moi et devant mes amis et arriver aux honneurs des hommes qui n’avaient aucune valeur, nous avons été proscrits à cause d’opinions politiques et de réformes très discutables, je ne puis pardonner au clergé le mal qu’il nous a fait. »
Doutre avait épousé à Montréal, le 28 septembre 1858, Angéline, fille de Jean-Baptiste Varin et d’Hermine Raymond. Devenu veuf l’année suivante, il se remaria avec Harriet Greene, originaire de l’état du Vermont. De cette union naquirent six enfants, trois garçons et trois filles. Il décéda à Montréal, le 3 février 1886, et fut inhumé dans le cimetière protestant du Mont-Royal. À parcourir une vie si remplie de travaux et de luttes, on demeure étonné de constater que Doutre n’avait pas encore complété sa soixante et unième année.
Moins d’un an plus tôt était disparu son inflexible adversaire ultramontain, Mgr Ignace Bourget. « Avec un peu plus d’esprit de conciliation de part et d’autre, nous eussions peut-être trouvé un terrain d’entente », devait confier Doutre à Honoré Mercier* et à son cousin Raoul Dandurand. Certes, mais, même en faisant abstraction du caractère et des convictions intraitables des deux hommes, il faut faire remarquer que l’intransigeance ultramontaine se heurtait à l’intransigeance radicale. Si ces deux fractions de l’opinion s’opposaient, ce n’était pas surtout pour la raison que leurs principes religieux ou areligieux étaient contradictoires, mais parce qu’elles voulaient l’une et l’autre imposer leur idéologie à la cité.
Les œuvres de Joseph Doutre sont : Constitution of Canada the British North America Act, 1867, its interpretation, gathered from the decisions of courts, the dicta of judges and the opinions of statesmen and others ; to which is added the Quebec Resolutions of 1864, and the constitution of the United States (Montréal, 1880) ; un discours reproduit dans Cour supérieure, Montréal ; plaidoiries des avocats in re Henriette Brown vs. la fabrique de Montréal ; refus de sépulture (Montréal, 1870), 35–64. Nous lui connaissons un roman, les Fiancés de 1812 ; essai de littérature canadienne (Montréal, 1844) et quelques nouvelles : « le Frère et la Sœur » et « Faut-il le dire ! ... » reproduites dans Contes et nouvelles du Canada français, 1778–1859, John Hare, édit. (1 vol. paru, Ottawa, 1971- ), I : 168–192. Doutre a aussi écrit « Du meilleur emploi qu’un citoyen peut faire de son existence tant pour la société que pour sa famille », reproduit dans l’Institut canadien en 1852, J.-B.-É. Dorion, édit. (Montréal, 1852), 144–192 ; « les Sauvages du Canada en 1852 ; Caughnawaga ; les Iroquois ; leur constitution politique et sociale ; leur langue ; usages, coutumes, superstitions », dans l’Institut canadien en 1855, J.-L. Lafontaine, édit. (Montréal, 1855), 190–225 ; ainsi que « Notice biographique sur le feu Édouard R. Fabre, Esr. [...] », reproduit dans ce même ouvrage aux pages 117–149.
AP, Saint-Clément (Beauharnois), Reg. des baptêmes, mariages et sépultures, 11 mars 1825.— Arthur Buies, Une évocation ; conférence faite à la salle de « la Patrie » jeudi, le 6 décembre 1883 ([Québec, 1883]).— Raoul Dandurand, Les mémoires du sénateur Raoul Dandurand (1861–1942), Marcel Hamelin, édit. (Québec, 1967).— L’Avenir, 16 juill. 1847-janv. 1852.— La Patrie, 4 févr. 1886.— La Presse, 3 févr. 1886.— La Vérité (Québec), 13 févr. 1886.— Bernard, Les Rouges.— Pierre Beullac et Édouard Fabre Surveyer, Le centenaire du barreau de Montréal, 1849–1949 (Montréal, 1949).— Thomas Chapais, Mélanges de polémique et d’études religieuses, politiques et littéraires (Québec, 1905), 93s.— L. C. Clark, The Guibord affair (Montréal, 1971).— L.-O. David, Histoire du Canada depuis la Confédération (Montréal, 1909).— Achille Erba, L’esprit laïque en Belgique sous le gouvernement libéral doctrinaire (1857–1870), d’après les brochures politiques (Louvain, Belgique, 1967), 677s.— J.-T.-D. Fortier, « La seigneurie de Beauharnois et la famille Ellice » (causerie prononcée devant la Soc. hist. de Rigaud, Rigaud, Québec, 21 mars 1958).— Lareau, Hist. de la littérature canadienne, 281s.— Augustin Leduc, Beauharnois ; paroisse Saint-Clément ; 1818–1919 ; histoire religieuse, histoire civile ; fêtes du centenaire (Ottawa, 1920).— Olivier Maurault, Le collège de Montréal, 1767–1967, Antonio Dansereau, édit. (2e éd., Montréal, 1967).— Léon Pouliot, Mgr Bourget et son temps (5 vol., Montréal, 1955–1977), IV : 26, 94.— N. S. Robertson, « The Institut canadien ; an essay in cultural history » (thèse de m.a., Univ. of Western Ontario, London, 1965).— Sylvain, « Libéralisme et ultramontanisme » ; La vie et l’œuvre de Henry de Courcy (1820–1861), premier historien de l’Église catholique aux États-Unis (Québec, 1955).— Marguerite Maillet, « Joseph Doutre et l’éducation », Co-incidences (Ottawa), 4 (1974), no 2 : 5–16.— Philippe Sylvain, « Un adversaire irréductible du clergé canadien-français du dix-neuvième siècle : Joseph Doutre », Cahiers des Dix, 41 (1976) : 109–125.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Philippe Sylvain, « DOUTRE, JOSEPH (baptisé Joseph-Euloge) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 18 sept. 2024, https://www.biographi.ca/fr/bio/doutre_joseph_11F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/doutre_joseph_11F.html |
| Auteur de l'article: | Philippe Sylvain |
| Titre de l'article: | DOUTRE, JOSEPH (baptisé Joseph-Euloge) |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1982 |
| Année de la révision: | 1982 |
| Date de consultation: | 18 sept. 2024 |


![[Joseph Doutre, Q.C.] [image fixe] / Studio of Inglis Titre original : [Joseph Doutre, Q.C.] [image fixe] / Studio of Inglis](/bioimages/w600.4607.jpg)